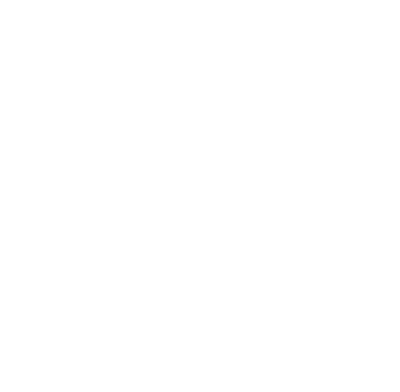Swarming

Lecture de carte
Quelques débuts de glissades et départs de cailloux nous ont fait de belles frayeurs ! 600m plus haut, nous voilà arrivés à l’emplacement prévu pour la nuit. La place est un peu moins raide mais il nous faudra aménager la zone avec des cailloux plats pour que l’on puisse y installer le camp.La planéité du sol est testée en faisant quelques exercices de nœud
Le camp est installé à proximité d’anciennes ruines du temps des mines
Une fois la toile de sol posée, on installe les matelas gonflables, les sacs de couchages ainsi qu’une bâche de toit pour nous protéger du soleil tapant. Pendant qu’une partie du groupe s’occupe d’aménager le camp, d’autres partent à la grotte installer les filets pour la capture des chauves-souris.Installation des filets pour les captures
Oriane et Benjamin installent une main courante pour assurer un passage un peu périlleux devant la grotte. Ainsi, les déplacements entre les filets de capture et le lieu d’inspection des chauves-souris peuvent se faire en toute sécurité. Une fois les préparatifs terminés, il ne reste plus qu’à attendre que la nuit tombe. La tentation est grande de partir explorer la grotte mais le dérangement doit être minimal si l’on ne veut pas que les chauves-souris se doutent de quelque chose. Étant habituées au lieu, les chauves-souris voleront « à l’aveugle » et n’utiliseront pas trop leur sonar car cela leur coûterait beaucoup d’énergie. En cas de doute, elles scanneront beaucoup plus finement leur environnement. Le rebond des ondes sonores trahit la présence des filets et les petits mammifères volants contourneront les pièges. Pour passer l’envie d’explorer la grotte, on visite une ancienne mine pas loin des baraquements en ruine. Malheureusement la galerie est impraticable suite à un effondrementà une dizaine de mètres de l’entrée. On découvre toutefois des graffitis datant de l’époque de l’exploitation de la mine. La soirée approchant, il est temps de mettre à feu trois réchauds à gaz pour cuire des pâtes. À la carte du soir, trois menus différents : pâtes pesto vert, pâtes pesto rouge et pâtes pesto rouge pas pareil que l’autre (peperoni). Pour accompagner le tout, quelques myrtilles cueillies par Sam la veille, noix, viande séchée maison de Raph et distillation de génépis dont Chab a le secret. Une fois les batteries rechargées, il est temps d’aller surveiller les filets. Tout le monde croise les doigts. Les paris vont bon train, il y a de tout entre zéro et cinquante individus. Le suspense diminue rapidement suite aux premières captures.Les chauves-souris sont prises au piège dans les poches des filets tendus devant la grotte
Raphaël en train de sortir une chauve-souris d’un filet
Raphaël retire les chauves-souris des filets et les met dans des petits sacs en tissu.Sac en tissus pour le transport des chauves-souris avant inspection
Ces petits sacs sont ensuite amenés à l’extérieur de la grotte en se tenant à la main courante installée plus tôt. Un peu plus loin, à l’extérieur de la grotte pour ne pas déranger le va-et-vient de chauve-souris, le petit sac est ouvert.
Le « pouce » des chauves-souris dépasse de l’aile, leur permettant de s’agripper et facilitant leur déplacement
Une fine couche de peau vascularisée relie les doigts permettant ainsi aux chauves-souris de voler tel un oiseau
La chauve-souris est examinée sous tous les angles pour déterminer son espèce, son âge, son genre ainsi que son « niveau d’excitation » par Anouk.En soufflant sur leur pelage, le sexe de l’individu est visible permettant d’identifier son genre et son statut reproducteur
Quel soulagement de voir que la grotte est habitée ! Trois espèces distinctes ont pu être identifiées : Les Murins de Natterer, de Daubenton et à moustaches (Myotis nattereri, daubentoni, et mystacinus). Ces trois espèces appartiennent au même genre des Murins, connu pour swarmer à l’entrée de grottes. Chaque capture est méticuleusement notée avec l’heure et les différentes informations utiles pour l’étude.Benjamin prend note des informations relevées par Anouk
La pilosité des pattes est un critère d’identification pour le Murin de Daubenton
Parfois certains individus sont parasités par des sortes de petites tiques
Après identification et prise d’informations, les chauves-souris sont relâchées Après une rapide formation sur le démaillage des chauves-souris prises dans les filets, je surveille à intervalle régulier les filets et m’initie à la pratique avec l’aide d’Anouk. Plusieurs petites mains étaient utiles lorsque 3 ou 4 chauves-souris étaient prises en même temps.Un des filets tendu à la sortie de la grotte
Chauve-souris prise au piège dans une poche du filet
Dès qu’elles sont prises au piège, il faut se dépêcher de les libérer pour éviter qu’elle ne se blessent et surtout pour éviter qu’elles détruisent les filets en les rongeant pour se libérer.Sortir les chauves-souris du filet demande de la dextérité et de l’entrainement pour ne pas trop stresser ni blesser les animaux
Il se peut que les chauves-souris arrivent à se démêler et repartent d'elles-même
Les chauves-souris essaient de se libérer des filets en les mâchouillant
Pour les sortir, il faut d’abord commencer par un côté en libérant une patte puis l’aile et ensuite vient l’autre côté.Toujours porter des gants pour éviter des infections suite à une morsure
Il faut impérativement porter des gants pour éviter les morsures, car comme tout animal sauvage une infection pourrait se développer (ils n’ont pas inventé les brosses à dent). (sur les images, Anouk n’a pas forcément de gant mais elle a la dexterité et l’expérience pour manipuler les individus sans se faire mordre.identification d’une capture par Raphaël
Raphaël reprend le relais de 3h à 6h du matin en espérant trouver un Murin de Bechtein, qui ne viendra finalement pas. En tout, cette nuit a permis la capture de plus de 50 individus !Raphaël dort devant la grotte pour reprendre les captures pour la fin de la nuit
Une belle nuit de capture pour cette grotte qui n’avait encore jamais été prospectée du point de vue des chiroptères. Après avoir laissé ma place vers une heure du matin, il est temps d’aller dormir quelques heures avant l’exploration spéléologique de la grotte. La nuit ne fut pas de tout repos avec quelques gouttes vers 2h du matin et une jolie averse vers 4h. Il a fallu monter un abri en vitesse pour les amis sans abri. J’ai réussi à percer mon matelas ultra light en voulant m’éloigner des gouttes, notre sol en dalle de granite n’est pas super confortable. C’est un peu la tête dans le cul que l’on retourne à la grotte pour l’exploration spéléologique au petit matin. Les filets sont déjà pliés par Anouk, tandis que Raphaël est sur le départ et ne nous accompagnera pas dans les tréfonds de la grotte.Oriane et Benjamin au début de la grotte de marbre
L’entrée de la grotte est magistrale, en forme de « triangle ».L’eau creuse un canyon de plus au plus profond dans le marbre au fil des millénaires
Après quelques mètres, on longe la rivière qui est responsable de la formation de ce canyon dans le marbre.Les lignes claires et sombres sont typiques du processus de sédimentation à l’origine du marbre
Aux abords de cette petite rivière, nous trouvons par endroit du sable très fin, brillant de mille feux. Ce sont en fait des petites feuilles de micas, des minéraux brillants, qui donnent cet aspect pailleté. On ne le sait pas encore mais on en sera recouverts de la tête aux pieds quelques mètres plus loin lorsque l’on devra se faufiler dans les veines du marbre blanc. La grotte est splendide ! Il y a une superposition de lignes sombres et de lignes claires, expliquée par la sédimentation des crustacés marins lors de la formation du marbre. Lors de la métamorphisation du marbre, ces lignes ont été bien visibles. L’érosion de la rivière dans le marbre a taillé la roche comme une œuvre d’art.arabesques créées avec le temps. Chaque goutte d’eau qui tombe participe au creusage du marbre nervuré
Ces lignes, à l’image des sillons dans le bois, donnent des formes très géométriques par endroit. Des petites cuvettes se sont formées avec le temps formant des patterns concentriques presque hypnotisants. Plus loin, la grotte devient moins belle avec passablement de boue recouvrant les parois. Le canyon devient aussi plus profond et périlleux. Les parois sont lisses avec peu de prises, il vaut mieux ne pas avoir le vertige car il n’y a pas besoin d’être docteur en physique pour connaître l’effet de la gravité du corps humain au fond de ce resserrement. Les plus téméraires, ou casse-cou je ne sais pas, continuent le chemin en opposition dans la faille. La progression continue ainsi quelques centaines de mètres entre canyon et boyaux serrés. Nous voilà de plus en plus les pieds dans l’eau, 5cm, 10cm et maintenant bientôt 20cm.la baignoire à Hamster
Après toute cette progression, nous arrivons au Hamsterbadely, soit « la baignoire à Hamster ». La suite semble un peu plus humide car visiblement, il faut imiter le hamster en rampant dans 20cm d’eau pour pouvoir avancer. L’orage étant prévu pour 15h selon les radars de météo suisse, on décide de faire demi-tour ici pour éviter de devoir dégringoler en bas la drupe sous la roille (si vous n’avez pas compris cette phrase c’est que vous n’êtes pas valaisan). Le retour se fait en 4ème vitesse pour rejoindre les autres à la sortie de la grotte et au camp. On s’arrête tout de même en cours de route pour prendre quelques images. Une fois le camp plié, débâché, il est temps de descendre avec une météo de plus en plus menaçante. Pas évident de ne pas se fouler une cheville ou un genou dans cette pente instable et un sac faisant 40 % de mon poids. 600m plus bas, la tentation est trop forte, rien de mieux pour se rafraîchir et détendre les pieds que de plonger dans la rivière glacée ! Sur la route, un arrêt obligé avant que chacun reparte chez soi rêver du swarming des chauves-sourisDe gauche à droite: Jolagaffe, Nicolas, Chab, Oriane, Lionel et Benjamin
Un grand merci pour votre lecture, j’espère que j’ai pu vous transmettre quelques détails croustillants sur cette grotte de marbre ainsi que ses habitants volants. Un grand merci à Anouk pour la mise en place et l’encadrement des captures ainsi que ta passion que tu as su nous partager ! Aussi un grand merci à Benjamin pour l’organisation de ce weekend ! Merci aussi à Oriane pour la relecture et la reformulation de l'article. Au weekend prochain pour la suite des aventures spéléologique au Wildhorn!