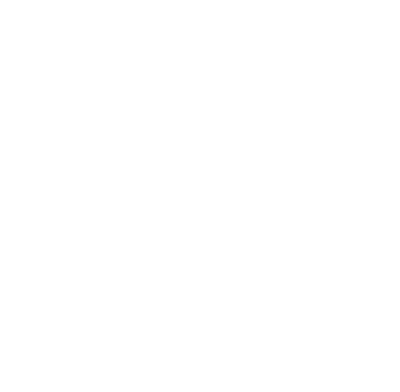Ultra grand angle très lumineux, le 10mm f2.8 Laowa

Un ultra grand angle lumineux tout en restant compact, pas besoin de beaucoup plus pour éveiller ma curiosité. J’aime beaucoup les ultra grands angles pour mes pratiques photos claustrophobiques. J’avais craqué pour le 9mm f5.6 de la même marque il y a quelques années pour ces raisons. Le plus grand angle linéaire plein format du marché.Ultra grand angle, il permettait des images qu’aucun autre objectif ne pouvait fournir ; cependant, f5.6 ce n’est pas vraiment lumineux. Ce 10mm, certes un poil moins grand angle, offre une ouverture de f2.8, ce qui le rend super intéressant pour la photo de ciel nocturne et d’espaces confinés peu lumineux. C’est aussi le premier objectif de la marque à intégrer un module autofocus, ce qui facilite grandement son utilisation.
espace confiné ou le grand angle permet d'amener une certaine grandeur dans l'image et de jouer avec les diagonales
Actuellement, mon setup grand angle se constitue comme suit : 10mm f2.8 Laowa, 14mm f1.8 GM Sony et 20mm f1.4 DG DN Sigma. Tous des ultra grands angles lumineux mais chacun avec leurs spécificités. Le 20mm est vraiment le roi de la photo astro avec son ouverture à f1.4 qui permet de capter tous les détails du ciel nocturne sans devoir recourir à des montures équatoriales. La focale de 20mm permet aussi d’avoir un centre de la voie lactée relativement important dans le cadrage là où, avec le 14mm, il commence à se faire plus discret. Le 14mm, lui, me permet d’avoir des cadrages plus osés avec des premiers plans plus imposants tout en incluant de larges paysages et toute la longueur de la voie lactée.Et le 10mm ? L’idée pour moi du 10mm est de couvrir un large champ de vision en une seule image (130°), permettant de faire des images en une prise de vue qui nécessitaient un panorama avec le 14mm ou le 20mm. C’est pour moi l’optique parfaite pour des time-lapses nocturnes montrant la voie lactée se déplacer dans un paysage.
Centre de la voie lactée avec le 10mm f2.8 Laowa
Son ouverture de f2.8 permet de capter les lueurs du ciel sans effet de filé, ce qui n’était pas possible avec le 9mm f5.6.
Comparons la taille relative du centre de la voie lactée par rapport au 14mm, 20mm et 35mm:
Centre de la voie lactée avec le 14mm f1.8 Sony
Centre de la voie lactée avec le 20mm f1.4 Sigma
Centre de la voie lactée avec le 35mm f1.2 Sigma
Bref, décortiquons un peu plus cet objectif de niche que j’utilise depuis un an maintenant.
Construction : Très bien construit comme tous les Laowa. Tout en métal, c’est robuste. Le 10mm est le premier objectif de leur nouvelle série avec un design teinté de bleu. Très métallique, sobre, on a un objectif qui fait mastoc et durable. Concernant la protection aux intempéries, forcé de constater que ce n’est pas parfait. Dans des milieux très humides et froids, de la condensation peut se créer derrière la lentille frontale (j’ai aussi eu ce problème avec le 9mm). On ne peut pas faire grand-chose que d’attendre que ça se dissipe. Ça n’arrive pas souvent et c’est vraiment dans des conditions extrêmes (sous terre avec 100% d’humidité et 5°C). L’objectif est très sobre et épuré. Juste une bague de mise au point et un switch AF/MF. Il faut donc contrôler le diaphragme via le boîtier (le petit dernier Laowa 12mm f2.8 a une bague de diaphragme). Ça peut être un peu perturbant de ne pas avoir le diaphragme sur le fût, il faut penser à contrôler ses réglages via le boîtier. L’essentiel est là avec le switch AF/MF qui permet de débrayer l’autofocus lors de prises de vue du ciel nocturne.Un bon point : malgré la grande ouverture et la focale, on peut visser des filtres de 77mm, très pratique pour faire des poses longues par exemple. Il faudra impérativement mettre des filtres slims pour éviter d’avoir un trop gros vignettage mécanique. Je n’ai pas vraiment testé avec des filtres mais il y a la possibilité, ce qui est assez remarquable avec les specs de l’objectif.
AF : En parlant d’autofocus, qu’en est-il ? On a tendance à dire que l’AF n’est pas forcément une nécessité sur ce genre de focale ultra grand angle car très rapidement, en fermant le diaphragme, tout est net avec l’hyperfocale. Je ne suis pas forcément d’accord avec ça car c’est piégeux. Se dire que si on ferme à f8, on fait la netteté à 2m et tout est net de 1m à l’infini est certes vrai en théorie mais en pratique, avec la définition de nos capteurs actuels de 60 Mpx, on est très net à 2m mais on est très moyen à 1m et à l’infini. Si on veut que notre sujet soit « razor sharp », il faut que la netteté soit faite sur lui et pas « juste » qu’il soit dans le champ de netteté. Évidemment, ça dépend de l’utilisation finale que l’on fait de l’image, taille d’impression, recadrage etc. Mais on verra que la qualité optique du 10mm n’est pas irréprochable et que plus on est proche de la zone de netteté, moins les défauts sont visibles. Tout ça pour dire que l’ajout d’un moteur AF chez Laowa, et même sur une optique ultra grand angle comme le 10mm, est un gros plus. Beaucoup moins de prise de tête pour faire la mise au point, un gain de temps certain et, par la même occasion, un gain en qualité d’image avec la netteté pile où elle doit être, là où en manuel on est plus approximatif (focus peaking) ou chronophage (zoom dans l’image). L'AF permet aussi de faire la netteté sur des sujets plus mobile et sort l'0bjectif de la photo de paysage uniquement.
sujet en mouvement ou l'AF est bien pratique même si très approximatif et hésitant si diaf fermé
Cependant, il ne faut pas s’attendre au standard d’AF de Sony ou Sigma avec des moteurs linéaires de dernière génération. L’AF du 10mm Laowa est très hésitant et lent, et pompe beaucoup si l’on cherche à faire la mise au point dans les bords.
Sa mise au point minimal de seulement 12cm, permet de bien mettre en valeur dès premier plan. La focal de 10mm permet d'exagérer la taille et vraiment le rendre impressionnant. Mais c'est assez dur à gérer et il faut souvent faire recourt au focus stacking
Premier plan très proche avec un focus stack pour les spéléo en arrière plan
Déformation : Le 10mm Laowa est vendu comme un « zero D », donc pas de déformation. Laowa a toute une gamme dans cette catégorie et ce qui est sûr, c’est que faire un 10mm sans déformation est très compliqué. Ils ont réussi à le faire en partie mais, du fait de la focale, il y a des compromis. On est sur l’un des plus grands angles pour plein format (seul le 9mm de la même marque est plus grand angle encore) et la gestion des déformations est vraiment impressionnante. L’horizon est bien plat, pas de bombage ni d’effet moustache, même si l’horizon n’est pas au centre. Les verticales sont bien droites et ne se transforment pas en tonneaux.
Les lignes droites restent droite, l'horizon n'est pas défromé
C’est vraiment impressionnant et très agréable et rend l’objectif utilisable pour des photos d’intérieur en archi, de reportage et de paysage. Ce n’est pas une optique « fun » comme un fish-eye ou autre, c’est une optique qui est vraiment exploitable. Après, dû à l’ultra grand angle, les lignes de fuite sont très exagérées. Si l’on tilt ne serait-ce que légèrement le boîtier, les verticales ne sont plus verticales et penchent vers l’intérieur de l’image (ou l’extérieur selon l’angle) mais elles restent droites. De par cet extrême angle de champ à ramener sur un capteur plat sans déformer les lignes droites, cela crée un effet un peu bizarre dans les angles. Je ne sais pas trop comment l’expliquer mais, en gros, si un objet traverse le cadrage à vitesse constante, sur la vidéo, il semblera aller plus vite quand il est au bord que lorsqu’il est dans le centre de l’image. Un peu comme s’il se faisait étirer dans les bords.
Bord de l'image étiré ce qui rend les parties du corps disproportionnellement grand par rapport à la tête moins déformée au centre
Cet effet est assez prononcé sur un ultra grand angle comme le 10mm, ce qui donne un effet bizarre si l’on regarde dans le viseur et balaie le paysage. Plus concrètement, ce n’est pas gênant pour une photo mais pour une vidéo, dans certains cas, ça peut donner un rendu bizarre. Où j’ai trouvé cela gênant, c’est dans un time-lapse de la voie lactée : on remarque que le déplacement de celle-ci n’est pas constant dans le cadrage.
https://youtu.be/ziNHZu_2TWwUn autre piège fréquent avec le cadrage très large des grands angles est la différence de distance entre le centre et les bords. Typiquement, sur une photo de paysage, le centre de l’image peut être à 30m mais, du fait de l’extrême grand angle, la distance dans les coins peut être à nos pieds, à 1m et automatiquement, avec une netteté à 30m, l’angle à 1m sera flou et passablement « étiré ».
Il faut donc faire particulièrement attention aux bords qui peuvent être vite flous et vite étirés/déformés. C’est une focale qui demande du temps pour être maîtrisée et qui s’applique à des images assez spécifiques ; je considère que c’est une optique un peu de niche.
Quand est-il de la qualité d’image ? Malheureusement, il y a des compromis pour réussir à faire un objectif aussi grand angle et lumineux tout en restant très compact (avec même la possibilité de mettre des filtres). La petite lentille frontale induit un très gros vignettage qui fait perdre pas mal d’étoiles dans les angles en photo astro. Il faudra compenser ce vignettage pour des photos de paysage ou d’archi.En cas de contraste dans l’image, les aberrations chromatiques (AC) sont très présentes surtout aux grandes ouvertures.
image plein cadre
AC bien visible et difficile à corriger dans les contrasts
Plus on s’éloigne du point de netteté et plus les AC sont marquées, d’où mon accent sur l’importance et l’aide de la mise au point automatique plus haut. Faire une bonne mise au point précise permet de diminuer les AC sur le sujet. Généralement, les AC sont faciles à supprimer avec un clic sur Lightroom mais pour le 10mm, il semble avoir beaucoup de peine à détecter les AC malheureusement.L’effet étoile est très marqué sur le soleil ou autre source lumineuse dès que l’on ferme un peu le diaphragme.
effet étoile à f16
effet étoile à f8
Avec seulement 5 lamelles de diaphragme, l’étoile est très marquée et vraiment « typique » des Laowa. On aime ou on n’aime pas mais ça fait définitivement partie de la signature de l’objectif.Sa mise au point à 12cm permet de faire des photos de sujets proches et de garder l’ambiance / environnement autour. Je n’ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de tests en mise au point rapprochée mais c’est quelque chose que je voudrais essayer avec le retour du beau temps l’année prochaine, avec des insectes et batraciens. À suivre.La qualité optique est bonne au centre et automatiquement, dans les bords, ça se dégrade assez vite, surtout avec cette problématique de distance qui change beaucoup dans les angles, qui ajoute un effet de flou pas toujours agréable à garder en compte. Il faudra penser à focus stacker de temps en temps pour éviter cette problématique.
Image non recadrée à f2.8 (notez le vignetage bien visible et les AC violet dans les arbres)
crop sur Lisa à f2.8. Qualité ok même si ca manque de détail. AC au niveau de la polaire blanchecrop dans l'angle à f2.8. Assez mou
image similaire à la précédente plein cadre à f8. Notez que les AC dans les arbres sont bien plus discret et le vignetage bien moins marqué
crop sur le sujet. AC bien moins marqué, plus de détail
Angle bien meilleur en fermant à f8
Coma La coma est vraiment bien maitrisé. Quelques effet un peu en croix sur les étoiles les plus lumineuses dans les angles extrèmes mais en comparaison à d'autres grand angles lumineux, c'est vraiment très bien maintenu. Le problème du vignetage qui attenue fortement les étoiles peux lumineuses est plus un problème que la coma.image non traitée, sans recadrage à f2.8. Notez le vignetage très prononcé.
Un peu de coma sur les étoiles les plus lumineuses (l'effet de fillé est du au temps de pause et pas à l'objectif)
Synthèse+ Ultra grand angle (130°), 10mm linéaire sur plein format (un des plus grands angles du marché), pas de déformation de l’horizon et des verticals. Permet des images impossibles sans pano avec d’autres focales
+Très lumineux pour sa focale, f2.8 parfait pour de l’astro et des images avec peu de recul et faible éclairage
+ Compact, <500 g
+ Construction tout en métal, solide
+ AF qui dépanne (premier objectif AF chez Laowa)
+ mise au point minimal à 12cm permettant des photos rapprochée tout en gardant l’enviromenent
+ peu de coma même à f2.8, très bonne optique pour de l’astro hotographie time laps (attention vinetage et impression de déformation dans les angles)
+ bon piqué au centre et bord dès f5.6
+ Pas de déformation de l’horizon, pas de bombage des verticals, très faible distorsion pour un 10mm
+ Filtre vissant 77mm (habituellement pas possible sur les grands angles lumineux)
+ Effet étoiles avec le soleil et autres objets lumineux, très marqué et reconnaissable (diaphragme à 5 lamelles)
+ Coma très bien gérée
– AF lent et hésitant en faible luminosité, AF qui pompe sur les bords. Très hésitant si diaf fermé
– Mauvaise tropicalisation, condensation dans des conditions extrêmement humides et fraîches
– Optique de « niche » qui demande une phase d’apprentissage pour maîtriser les ultra grands angles (netteté dans les bords, étirement dans les bords et lignes de fuite)
– Piqué pas fou fou à pleine ouverture et mou dans les bords
– Vignettage très marqué faisant perdre des étoiles dans les angles en astro. À compenser en paysage. Moins visible à partir de f5.6
– Aberrations chromatiques fortes et difficiles à corriger, diminue drastiquement en fermant à f5.6 et +
– Effet d’étirement dans les bords en vidéo / time-lapse
Quelques images faites avec le 10mm pour vous montrer ses possibilités et ces angles de vues originaux