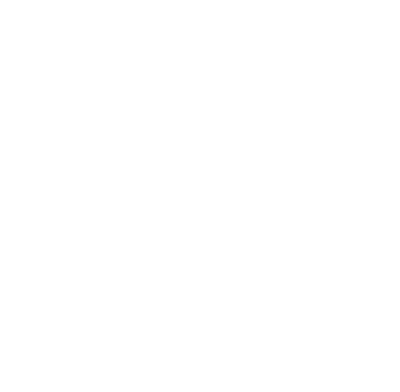42h à 4554m Signalkuppe: Capanna Margherita
Après avoir passé une nuit presque sans fermer l’œil au bivouac Rossi e Volante (3878m), il est temps de dissiper le doute. Est-ce que le mal d’altitude est une légende ou juste une coïncidence ? De plus, cette fin de semaine s’annonce très prometteuse, pas le moindre nuage à l’horizon. Sans nuage, la chaleur n’est plus retenue la nuit et les températures deviennent glaciales. De quoi tester mon nouveau sac de couchage Cumulus d’expédition avec une température confort de -25°C.
Les jours de congé sont posés, il est temps de partir pour 4 jours en autonomie dont 2 nuits sur le toit de la Suisse. Après 4027, 4164, 4195 et 4206m, il est temps de monter un cran plus haut à 4554m !
Image prise par Stéphane
Une fois le masque covid en place, avec nos sacs chargés à 19kg, on se dirige vers la station de Zermatt. L’ascension du Breithorn ayant déjà été faite depuis la station, le trajet Zermatt-Furi n’est plus à faire. On profite donc des remontées mécaniques sur la première partie puis les peaux sont collées à 1800m. La montre GPS est enclenchée et les premiers mètres de dénivelé derrière nous. Avec Stéphane, nous nous faufilons dans la vallée du glacier du Mont Rose.
Après quelques resserrements, traversées de rivière et montées de rampes en bois, nous voilà au pied du glacier. La température est passée de +3°C au soleil à -11°C. Elle ne passera plus au-dessus de la barre les -10°C pour les 4 prochains jours.
Au pied du glacier, la fonte de l’été passé révèle une grotte. On se permet un petit détour pour visiter ce palais glacé. Les températures glaciales ont transformé le sol de la grotte en cascade de glace.
Au bout du tunnel, on aperçoit le Breithorn qui nous toise du haut de ses 4164m.
Mais l’horloge continue de tourner. Si l’on veut atteindre l’étape intermédiaire, la cabane Monte Rosa avant la nuit, il faut nous remettre en route. La trace slalome entre les séracs et les crevasses et 5h plus tard nous voici au local d’hiver de la cabane de Monte Rosa.
On profite de l’altitude modérée pour passer une dernière vraie nuit reposante à 2800m. Le lendemain, on rechausse les skis avant le lever du jour pour gravir les 1700m nous séparant de la seconde cabane, la capanna Margherita.
Le ciel est trop couvert, le lever de soleil ne nous incite pas à sortir l’appareil photo. La seconde partie du glacier est moins stable, il faut bien choisir par quel côté passer pour ne pas être bloqué par les crevasses. Encordés, on traverse ces paysages incroyables avec des blocs bleu glace de tous côtés.
L’ascension continue jusque dans les nuages et perturbe notre orientation, on ne voit plus à 3m. Stéphane corrige ma trajectoire régulièrement basée sur sa montre gps pour passer par les bons cols et éviter le gros des crevasses. Voilà une éternité que nous avons quitté la cabane du Mont Rose et chaque pas devient un combat. Je m’essouffle rapidement et dois m’arrêter régulièrement pour reprendre mon souffle. Suis-je fatigué ou est-ce le manque d’oxygène lié à l’altitude qui se fait sentir ? Stéphane me dit que l’on est à 3900m d’altitude, on est encore loin des 4500 que l’on doit atteindre.
Je décide de forcer ma respiration en inspirant à fond de manière bien exagérée et ça marche. La fatigue disparaît et me voilà comme avec un second souffle.
On continue la montée qui semble interminable mais nous voilà bloqués, une longue crevasse nous empêche de continuer. On la longe pour trouver un endroit plus facile à traverser. Un passage semble faire l’affaire mais nous oblige à défaire nos skis pour continuer en crampons, c’est "vive glace".
On continue ski au dos et un court instant, le brouillard laisse apercevoir la fameuse capanna Margherita. Hourra, nous touchons au but, encore une petite centaine de mètres et nous y sommes.
Avant d’arriver au sommet, dans la pente glacée, les crampons automatiques tout neufs de Stéphane se décrochent. Ils n’ont pas bien été serrés et le voilà bloqué dans la pente dans une position bien inconfortable. Je le rejoins et lui refixe les crampons après les avoir raccourcis d’un cran. Après une petite pause pour réchauffer mes doigts, on attaque la dernière montée aux crampons et piolet nous voilà arrivés sur la terrasse de la cabane. La vue est ? blanche ? Espérons que les nuages se dissiperont pour que l’on puisse apprécier le paysage. On entre dans le local d’hiver de la cabane, quel plaisir de ne plus avoir de vent, on a l’impression de gagner 10 degrés d’un coup alors qu’il fait -17°C.
Avant de partir, on avait fait le choix de partir avec uniquement 600ml d’essence pour le réchaud au risque de ne plus pouvoir faire fondre la neige sur la fin (et donc devoir redescendre de manière prématurée). Mais le local d’hiver de la capanna Margherita est juste incroyable, une petite cuisinière avec du gaz est mise à disposition avec quelques sachets de thé.
Sans perdre un instant, la neige fond dans la casserole et les sachets de thé attendent sagement l’infusion. C’est fou la différence de mentalité de cette petite cabane Italienne avec une cuisinière, des statues de la sainte Margherita partout et une radio de secours pour 0.- la nuit !
On profite de la fin de l’après-midi pour s’installer dans les dortoirs et se réchauffer dans nos sacs de couchage. Rapidement le mal de crâne surgit, forcément, la sieste à 4550m d’altitude n’est pas si évidente même si Stephane dit m’avoir entendu dormir O:)
La sieste arrive à son terme et le mal de crâne dû à l’altitude se fait de plus en plus pesant. Il est temps de sortir du sac de couchage pour photographier le coucher de soleil. Malheureusement, on a encore la tête dans les nuages, rien à mettre en boîte ce soir. Juste le temps de manger un Lyophilisé avant de se remettre sous la couette. La nuit fut un cauchemar avec quelques dizaines de minutes de sommeil consécutives, maintenant c’est sûr, l’air est plus fin à 4500m.
Le lendemain matin, les premières lueurs du jour nous font ressortir de nos sacs. Un coup d’œil par la fenêtre pour s’assurer que les nuages ne sont plus là.
On n’aperçoit pas grand-chose mais les couleurs sont prometteuses. On superpose les couches de doudoune, enfile le pantalon de ski par-dessus le pantalon thermique et on sort de la capanna.
D’un coup, le mal de crâne, la fatigue de la montée disparaît. Autour de nous, à 360°, les Alpes. De Milan, Berne, des dents du midi à pic Visio, on voit tout.
Toutes les montagnes, même les 4000 semblent petites. La sensation de voir les montagnes depuis en haut est vraiment étonnante pour nous qui vivons habituellement à leur pied. L’effet est encore plus marqué par la mer de brouillard s’étendant dans la plaine, on se croirait en train de survoler les Alpes en avion.
La beauté du paysage nous fait presque oublier le vent qui fouette les arêtes. Des bouts de glaces sont arrachés dans les pentes raides et viennent nous fouetter le visage.
Par moment, il faut même se rouler en boule pour éviter de basculer. Avec ce vent, tout devient plus difficile, la respiration mais aussi la sensation de froid qui gèle rapidement les extrémités.
On avait prévu de réaliser l’ascension de 3 autres 4000m aujourd’hui mais il est trop risqué de tenter les sommets avec ces rafales de vents imprévisibles et violentes. On passera la plus grande partie de la journée cachés au chaud dans le sac de couchage à essayer de survivre au manque d’oxygène.
Ici un petit panorama des montagnes nous environant
On ressort affronter le vent lors du coucher de soleil.
Une fois le soleil disparu derrière l’horizon, avant de tenter quelques photos de ciel nocturne, il est temps d’allumer le réchaud à essence pour fondre de la neige et manger quelques lyophilisés. Mais avant ça, on recouvre le détecteur d’incendie avec une balaklava pour éviter de faire déplacer les secours inutilement.
Pourquoi utiliser notre réchaud à essence si nous avions un réchaud à gaz à disposition dans la cabane? C'est pour faire un test en condition réel (froid et fonte de neige) pour mieux estimer notre consommation d'essence pour les fois ou n'aurons pas une cuisinière à gaz à dispo.
Le mini croissant de lune est sur le point de se coucher aussi, il est l’heure des prises de vue nocturnes. Appuyés sur la rambarde de la cabane, il faut attendre quelques secondes d’accalmie du vent pour tenter de prendre une image pas trop floue. Le vent est tellement fort que l’appareil a failli glisser entre les moufles quelques fois.
Sur cette photo, j'ai surpris Stéphane en train de s'alléger. Pour ne pas laisser de traces, il faut creuser dans la neige puis recouvrir le champ de bataille. Il faut aussi être particulièrement rapide pour faire son affaire car il ne faut pas oublier que l'on est en proie a des rafales de vents et qu'il fait dans les -20°C.
Lorsque je parle de pollution lumineuse, j’explique souvent que la principale cause de pollution du ciel au sud des Alpes nous vient de Milan. Généralement, on a de la peine à y croire car Milan nous paraît si éloigné.
J’ai profité d’être au sommet de nos Alpes pour photographier en direction du sud. Le champ étant libre depuis ce point de vue, j’ai une vue directe sur Milan démontrant l'éblouissant éclat de la ville italienne.
Il est temps de retourner se coucher en espérant que le vent se sera calmé le lendemain matin pour que l’on puisse enfin gravir les sommets prévus. Mais la seconde nuit est pire que la première, en plus du mal de crâne, quelques nausées s’invitent m’obligeant à faire des pauses pendant la nuit en me redressant et en forçant ma respiration pour me réoxygéner. L’air est maintenant à -20°C à l'intérieur. Plus l’air est froid et moins il peut contenir d’humidité, il me faut donc me réhydrater très régulièrement pour éviter d’avoir une gorge extrêmement sèche. Évidemment, il faut dormir avec la gourde d’eau dans le sac de couchage car elle ne resterait pas liquide après 1h au froid. Le vent souffle encore plus fort qu’auparavant pendant toute la nuit, on entend des bouts de glace s’écraser contre les parois de la cabane et tout le cabanon vibre au rythme des rafales de vent. Je me rassure en disant que ce n’est pas le premier hiver que la cabane doit traverser. Je commence à comprendre pourquoi la plupart des alpinistes choisissent cette destination en été…
Au petit matin, la vue est toujours aussi splendide et nous fait vite oublier cette nuit à nous battre contre nous-même. Le vent est plus fort que jamais et on se rend à l’évidence, sur les 4 4000 prévus, nous ne ferons que le Signalkuppe 4554m qui est le sommet où nous venons de passer nos dernières 42h !
Je profite de faire un panorama à 360° du sommet de nos alpes, même 4-5 panoramas car le taux d’images floues sera élevé avec ces rafales de vent.
Tous les sommets deviennent roses sauf le Cervin. Malgré ses 4478m de haut, le Cervin est dans l’ombre d’un autre géant, le massif de mont Rose avec la pointe Dufour qui est le plus haut sommet de Suisse avec ses 4634m. Incroyable de se dire que l'on fait de l'ombre au Cervin!
Il est temps de dire au revoir à cette cabane qui nous aura été d’une grande aide dans ces conditions difficiles. J’ai porté une tente "exped" pour tenter un bivouac à l’extérieur mais les conditions auraient été trop extrêmes pour l’armature.
Le sac est compacté au maximum, les skis sont fixés au sac car la première partie doit se faire en désescaladant en crampons et piolet. La prise au vent avec les skis dans le dos est massive, la descente se fait prudemment car les rafales de vent ont tendance à nous décrocher. Les temératures atteignent maintenant les -24°C! La vue est bien dégagée et une fois quelques centaines de mètres plus bas, le vent se fait quasiment inexistant. La descente se fait sans encombre dans un paysage magnifique... C’est ce que je voudrais dire mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Pour prendre une image de Stéphane en ski avec les glaciers, je prends un peu d’avance. Je ne fais pas très attention et quelques contours plus tard, je passe sur un pont de neige qui se dérobe sous mes skis. Je ne vois rien venir, avant de comprendre ce qui se passe, me voilà couché face contre la neige. La moitié de mon torse est en équilibre sur un faible pont de neige et je sens que mes deux skis sont dans le vide ainsi que mon bras droit. A la manière d’un phoque sur la banquise, je me hisse hors de la crevasse et rampe sur le côté.
Je dois lever mon pied droit assez haut en le tordant un peu pour sortir le ski qui bloque contre les parois de glace. Me voilà sur la glace ferme, je vois que Stéphane m’observe quelques mètres plus haut. J’enlève mon sac et observe les lieux du sinistre. Après comptage, un de mes bâtons est manquant. Je me couche et rampe à nouveau près de la bouche de glace, j’observe l’intérieur de la crevasse mais je n’aperçois pas le bâton. A vrai dire, je n’arrive même pas à déterminer la profondeur du trou. Si le pont de neige n’avait pas réussi à soutenir la partie haute de mon corps, je n’ose imaginer l’état de mon corps au fond de cet abîme.
Après avoir fait le deuil de mon bâton, j’envoie un bout de la corde à Stéphane, on s’assure et on traverse la crevasse et les suivantes encordés. La descente se fera avec un bâton dans la main droite et le piolet dans la main gauche. Sur le retour, on croise des groupes faisant des descentes en héliski ainsi que quelques guides. L’un d’entre eux me demande ce qui s’est passé à mon deuxième bâton après lui avoir expliqué la mésaventure il me répond : « des bâtons, on en fabrique tous les jours ».
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée en toute sécurité.